Régulation sur le nouveau génie génétique: Notre Position
En collaboration avec une large alliance d'une soixantaine d'organisations de soutien, le ASGG indique dans une prise de position les lignes rouges à ne pas franchir.
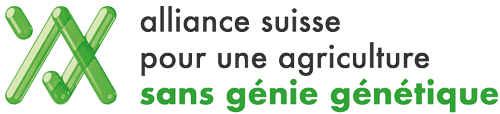

Brochure d'information de Friends of the Earth (2020) sur les risques des sprays à ARN (en anglais)

Vote serré : division au sein des membres de l'UICN. (Image : UICN/Marcus Rose/Workers Photos)
IUCN/Marcus Rose/Workers Photos
IUCN/Marcus Rose/Workers PhoIUCN/Marcus Rose/Workers PhIUCN/Marcus Rose/Workers Photos
En octobre 2025, lors de son huitième congrès à Abu Dhabi, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), principale organisation mondiale dans le domaine de la conservation, a rejeté une demande de moratoire mondial sur la dissémination d’organismes sauvages génétiquement modifiés. Cette décision est intervenue malgré l’absence de bases scientifiques solides et de cadres réglementaires efficaces garantissant la sécurité de telles pratiques, et alors que de nombreuses organisations internationales réclament depuis des années un moratoire fondé sur le principe de précaution. La perspective de dissémination d’organismes issus du forçage génétique (« gene drive »), une technologie capable de se propager rapidement dans des populations sauvages, suscite des inquiétudes particulières.

Les facteurs socio-économiques font que les solutions technologiques telles que le génie génétique ne contribuent pas nécessairement à une utilisation plus respectueuse des ressources. (Image : Ilham Wicaksono, Unsplash)
IUCN/Marcus Rose/Workers Photos
IUCN/Marcus Rose/Workers PhoIUCN/Marcus Rose/Workers PhIUCN/Marcus Rose/Workers Photos
Une étude publiée en avril 2025 par des chercheurs américains conclut que l’utilisation de semences génétiquement modifiées (GM) entraîne, à long terme, une augmentation de l’usage des pesticides. L’analyse repose sur des données couvrant 30 ans concernant des cultures GM tolérantes aux herbicides (soja, maïs, colza), complétées par une étude de cas empirique sur le coton Bt1 en Inde.

Le SAG et l’ASGG célèbrent le succès durable du moratoire sur le génie génétique et continuera à s'engager en faveur d'une agriculture diversifiée sans génie génétique.
Le 27 novembre 2005, un événement historique s'est produit en Suisse : l'initiative « Sans OGM » a été acceptée dans les urnes, ce qui est rare pour une initiative populaire. La population suisse a dit « oui » au moratoire sur la culture commerciale d’OGM à 55,67 % et dans tous les cantons. Cette décision envoie un signal clair : la majorité des Suisses ne veulent pas d'OGM ni dans leurs champs, ni dans leurs assiettes.

La classification des plantes NGT-1 comme « faible risque » n'est pas scientifiquement fondée.
Le soir du 3 décembre 2025, le dernier trilogue sur la déréglementation des nouvelles techniques génétiques dans l'UE s'est tenu à Bruxelles sous la présidence danoise. Au cours d'une réunion qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit, une proposition de compromis a été élaborée, qui menace gravement la stratégie gagnante de l'agriculture suisse et qui est dépourvue de tout fondement scientifique. Le génie génétique devrait être autorisé dans l'agriculture sans évaluation des risques, sans réglementation de la coexistence et avec un étiquetage limité. L’ASGG critique vivement cette proposition. Il n'est pas encore certain qu'elle sera adoptée telle quelle lors du vote final.

Les consommateurs allemands, autrichiens et suisses sont unanimes : les OGM doivent être étiquetés ! (Image: Shutterstock)
Les chiffres d'affaires du label « Sans OGM » de l'association allemande pour les aliments sans OGM (VLOG) se sont consolidés à un niveau élevé en 2024. C'est ce que montre un rapport de marché récemment publié par l'association. Ce rapport comprend d'autres enquêtes et études intéressantes sur l'étiquetage des OGM et montre que, surtout en cas de déréglementation des nouvelles techniques génétiques, les labels sans OGM pourraient continuer à gagner en importance.

La classification des plantes NGT-1 comme « faible risque » n'est pas scientifiquement fondée.
Selon les plans de déréglementation de la Commission européenne, les plantes issues des nouvelles techniques de génie génétique qui ne contiennent pas de gènes étrangers devraient à l'avenir être mises sur le marché sans évaluation des risques. La raison invoquée : ces plantes présenteraient un risque moindre, car l'intervention génétique serait précise, minimale, presque naturelle. Cette affirmation est dépourvue de tout fondement scientifique, comme le montre une publication préliminaire de l'Office fédéral allemand pour la protection de la nature (BfN).